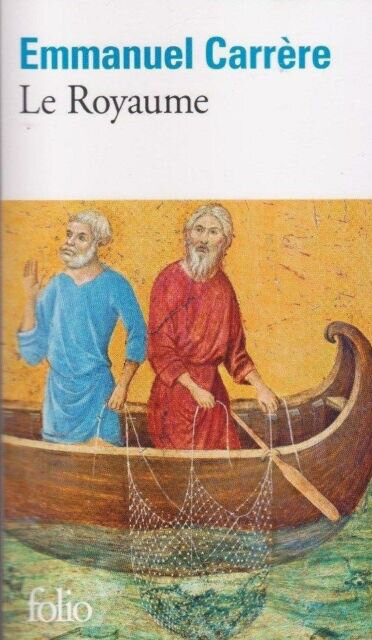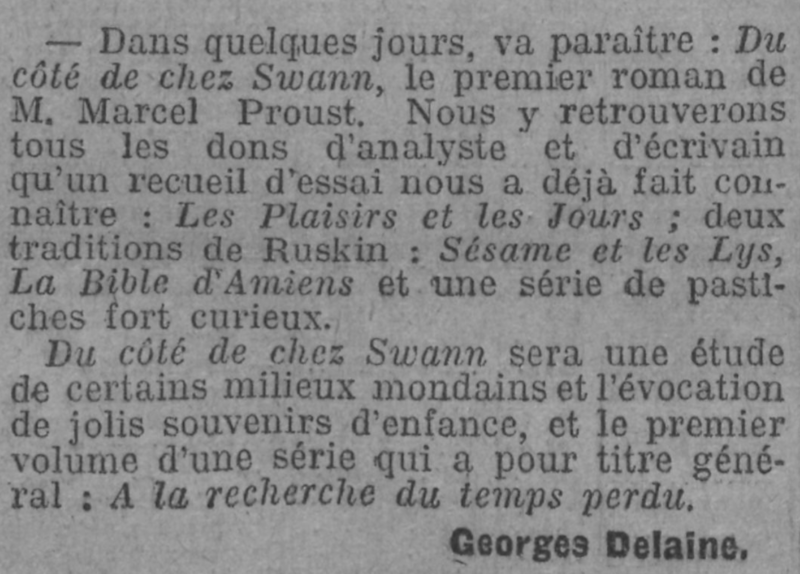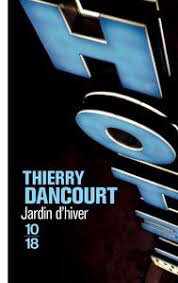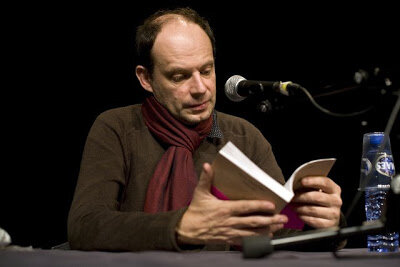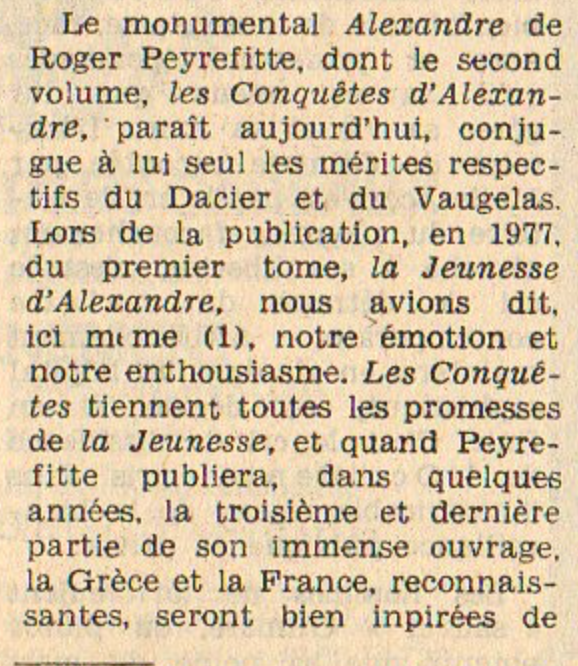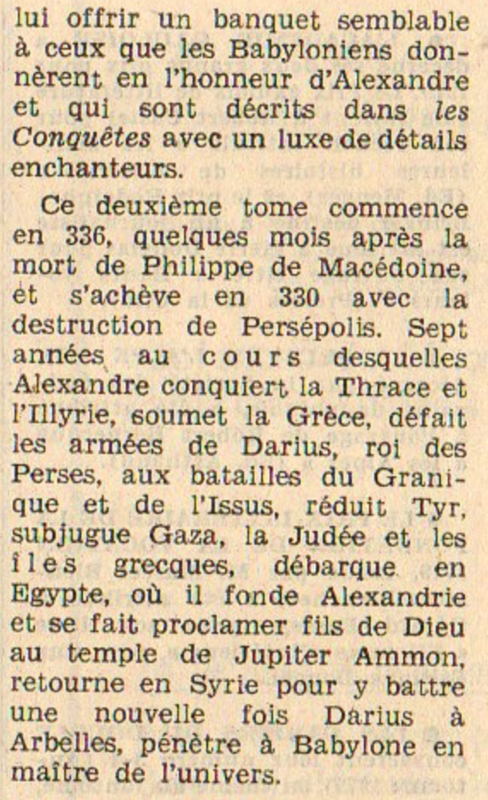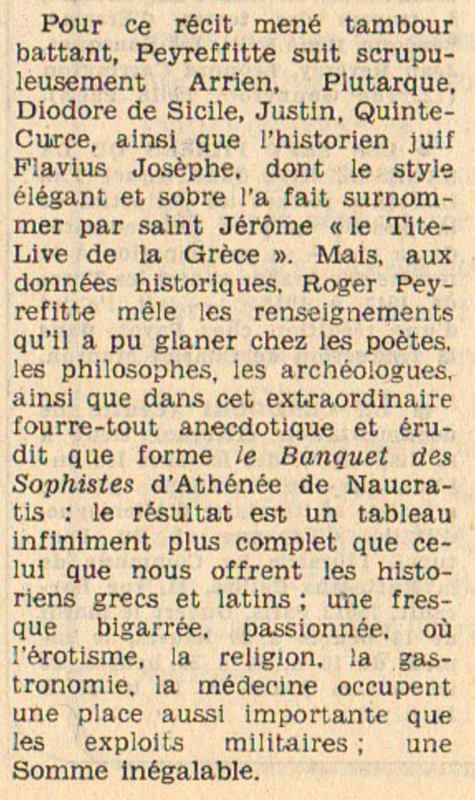Qui lit encore Jacques Perret ? Une poignée de nostalgiques, et quand bien même, cela suffirait à maintenir vivant cet écrivain si français disparu en 1992. Mais ne vous méprenez pas : ces lecteurs-là ne regrettent pas tant une époque qu’une certaine manière de s’en sortir avec les mots, de nouer la langue commune à la langue classique pour la faire sourire. Cela a donné des récits (Le Caporal épinglé), des romans (Le Vent dans les voiles, Les Biffins de Gonesse, Mutinerie à bord), des chroniques (Objets perdus), des souvenirs (Raisons de famille) et un Bande à part qui fut couronné du prix Interallié 1951, cérémonie à laquelle l’auteur arriva en retard, ce qui lui valut d’être accueilli par son complice Antoine Blondin sur un tonitruant : « Le voilà, Perret ! ».
Dernier en date, Dans la musette du caporal (126 pages, 15 euros, Le Dilettante), une sorte d’inédit rassemblant sept textes jusqu’alors dispersés dans différentes revues qui les publièrent entre 1945 et 1964. L’armée, la guerre, le camp. Et au-delà de cette ligne d’horizon, ce qui dépasse l’homme et le pousse plus loin que lui-même : la fraternité des clandestins, le champ d’honneur, l’amour de la patrie et, comme il dirait, autres valeurs qui ne plus parlent qu’aux dinosaures tricolores. Car Jacques Perret était de ces rares écrivains qui s’était fait une idée de son pays et s’y était tenu contre tous les vents et nombre de marées ; ses nombreux articles des années 50 et 60 dans Aspects de la France, Arts, Combat et Itinéraires en témoignent. Il ne cessait pas d’aimer sa patrie quand elle cessait d’être aimable. Perret était pour le trône et l’autel, tranquillement, sans agressivité, mais fermement, ainsi qu’il le rappela devant l’assistance médusée dans les tous premiers temps d’Apostrophes. Catholique et monarchiste de toujours et pour toujours. Ce qui ne l’empêcha pas, juste après sa quatrième tentative d’évasion réussie du stalag, de prendre le maquis et de rejoindre aussitôt l’ORA (Organisation de Résistance de l’Armée) tenue par des officiers de carrière pas très communistes. La moindre des choses pour celui qui se présente comme « Français, c’est à dire contribuable et mobilisable ». Il choisit la mitraillette car il ne croit qu’à la guerre à portée d’injures, et que les porte-parole sont rarement les porte-fusils. Maquisard non par idéologie mais par pure et instinctive réaction d’honneur : comme il est des circonstances où il serait déshonorant de ne pas s’engager, il n’a même pas réfléchi tant cela lui paraissait naturel. Porté par un même élan, en pleine guerre d’Algérie, il prit fait et cause pour son fils, un parachutiste OAS de 24 ans qui risquait gros pour avoir voulu supprimer un ennemi de l’intérieur. Cela lui valut quatre condamnations pour offense au chef de l’Etat (le général, par lui surnommé « célèbre diplodocque aléatoire ») et le retrait de sa médaille militaire.
La mosaïque de ces articles aux allures de nouvelles reflète bien son image de réfractaire, franc-tieur et marginal. En prime, on trouve quelques curiosités, comme les pages de « Scarlett derrière les barbelés », où l’ancien prisonnier de guerre rend hommage à Margaret Mitchell pour son Autant en emporte le vent : grâce à ce roman, tout le camp fut pris de scarlettine :
« L’ombre de cette fille émouvante nous suivait partout, elle nous parlait, nous encourageait, nous versait l’espoir et nous rendait la fierté. Les sentinelles devenaient les carpetbaggers, la faim, la misère et l’amour de Scarlett étaient les nôtres, la France était le Sud, et nous faisions le coup de feu avec le général Lee pour sauver l’honneur d’une société qui fut la nôtre, son idéal, ses fanfreluches et sa foi. Bénie soit Scarlett qui nous a susurré sous l’œil des barbares la merveilleuse histoire d’une civilisation dont nous voici les fragiles et derniers champions (…) Scarlett, agent secret de la civilisation dans les barbelés, nous a dit : « Soyez sudistes ! »
Rarement un roman populaire aura eu droit à une telle reconnaissance, en prise directe non avec ses qualités littéraires ou artistiques mais avec son cœur battant et son âme. Deux autres textes rapportent avec finesse et émotion le pèlerinage de Perret sur ses lieux de captivité en Allemagne, huit ans après la guerre. « Pour Ramos », éloge du maquisard inconnu et petit traité de fraternité, est tout aussi vibrant, dans sa manière, toute de pudeur et de discrétion. Mais le plus personnel de ces récits, et le plus inoubliable, celui qui ouvre le recueil, n’est pas consacré à la seconde guerre mondiale mais à la précédente : « La mort de mon grand frère » nous transporte dans la France d’avant où l’on comprenait « quelle institution miraculeuse était la famille où sans être d’accord sur rien on peut s’embrasser à propos de tout (…) Sur Dreyfus, déchirons-nous, mais sur Fachoda,

holà ! ». Si une nostalgie perce dans ces pages bouleversantes, c’est bien celle d’une harmonie perdue. De son propre aveu, dans la sienne, on cultivait depuis 1870 l’amour de la patrie comme « un sentiment dramatique, obligatoire et satisfaisant ». Avec le culte primitif de l’honneur, il convient (lorsqu’il publie ce texte dans la Revue des deux mondes, en 1964) que ce sont là des traits de mœurs tombés en suspicion et désuétude. Qu’en dirait-on aujourd’hui…En août 1914, Jacques Perret a 13 ans. Il voit son père et son frère partir à la guerre. Le premier est fait prisonnier ; quant au second, tireur, il savait que tout boutefeu doit s’attendre à des retours de flamme. Les casquapointes le lui ont rappelé cruellement. Leur mère se replia dignement « dans les larmes et sous les armes » ; écrasée de chagrin, elle n’en continua pas moins jusqu’au bout à « surveiller la France en veillant son enfant », s’abîmant dans la désolation jusqu’à ce qu’elle fut recrue de jours. Les lignes rapportant le voyage du père et du frère avec des déterreurs de cadavres, sur le champ de bataille, dans une Picardie transformée en « plaine figée dans son apocalypse », forment une page d’anthologie. Dans ce In memoriam comme dans ses récits de mer, il écrit si bien le français qu’on se demande parfois dans quelle langue il écrit.
Jacques Perret était un homme contre, un homme du refus. Rien de ce qui était français ne lui était étranger. Folliculaire de la réaction, écrivain du transcourant « plume Sergent-Major », styliste hors-pair qui buvait avec soin afin d’éviter tout faux-pli dans le jugement, il eut la faiblesse de ne jamais dire non à l’aventure et au voyage. Il tenait la littérature pour un art d’agrément qui aurait pris tournure de gagne-pain. Il aimait Aymé et aussi Bloy, Blondin, Conrad, Dos Passos; il en tenait pour le duc d’Anjou et la dimension sacrificielle de la messe selon saint Pie V. J’avais été à sa rencontre à la fin de ses jours, dans son appartement près du Jardin des Plantes où il cachait son bonheur d’être Français. Il avait quelque chose du Jacques Dufilho de Milady et du Crabe-tambour, les traits comme les idées, mais en moins âpre, plus doux. Dans sa chambre, il y avait deux cadres : dans l’un, le grand Turenne ; dans l’autre, son grand frère.