Un père sans enfant de Denis Rossano
Quoi de plus banal, hélas, qu'un couple qui se sépare et dont la femme empêche l'homme de voir son fils. Même dans le milieu du cinéma, comme c'est le cas ici, cela ne doit pas être rare. Cela le devient un peu moins lorsque la séparation de ces deux êtres, qui se sont jadis aimés, arrive dans l'Allemagne où Hitler va bientôt prendre le pouvoir. Cela ne l'est plus du tout lorsque l'homme deviendra un cinéaste célèbre en Amérique où il devra fuir pour protéger sa liberté et surtout la vie de sa seconde épouse qui est juive alors que son fils, Klaus, deviendra un jeune acteur dont la beauté en fera une icône de la jeunesse nazi; mais il sera envoyé à la mort sur le front de l'est lorsqu'il aura cesser de plaire au docteur Goebbels, le maitre du cinéma nazi qui soupçonna Klaus d'homosexualité, cela d'après les mémoires de Veit Harlan, à moins que la véritable raison de la disgrâce du garçon ait été que son père soit le réalisateur en Amérique d'un film ant-nazi! Le cinéaste n'est autre que Sierck, alias Douglas Sirk qui dans son pays d'adoption, deviendra le grand spécialiste des mélodrames.
Rock Hudson, Jane Wyman et Agnes Moorehead entourent Douglas Sirk sur le tournage de Tout ce que le Ciel permet
Avant cela le cinéaste parviendra à échapper avec sa femme à la Gestapo d'une façon rocambolesque, quant à la mère de Klaus membre du parti nazi et qui a encouragé son fils à rejoindre les jeunesses hitlériennes, elle se serait suicidé en Allemagne en 1947...
De cette histoire au potentiel romanesque extraordinaire Denis Rossano en a tiré un livre assez ennuyeux qui ne sait jamais choisir entre le roman, les mémoires et l'essai. Etre romancier c'est justement choisir entre les possibles d'une vie et lorsque l'on s'empare d'un être qui a réellement exister éclairer les zones d'ombres de la vie de son sujet et donner des réponses crédibles aux questions que l'on peut se poser sur son existence. Ce que fait très bien, pour rester dans le monde du cinéma, Osamu Yamamoto dans son manga "The red rat in Hollywood" à propos de Billy Wyler.
Sur le tournage de "Le temps d'aimer et le temps de mourir" (RONALD GRANT / MARY EVANS / SIPA)
On songe avec regret quel formidable roman aurait tiré le regretté Philip Kerr de cette tragédie. D'autant que Sirk tient une place à part dans la nébuleuse des professionnels du cinéma allemand qui ont fui le nazisme. Il est parti un peu tard au Etats-Unis, il traîna longtemps sur son compte un certain doute quant à ses accointances avec le régime nazi. N'a-t-il pas tourné avec la plus grande star du cinéma nazi, Zarah Leander merveilleusement mis en lumière dans "La Habanera", en 1937, qui préfigure tout les grands mélodrames que Sirk tournera ensuite. La Habanera, dont le scénario a quelques résonances avec la vie de son metteur en scène sera le dernier film que Sirk tournera pour l'UFA, la grande société allemande de cinématographe.
Mais le véritable sujet du roman est Klaus. Il commence sa courte carrière d'acteur à l'âge de neuf ans, il joue le fils du fermier Hans dans "Die Saat auf", sa mère a également un petit rôle dans ce film. À l'été de 1937, au Caire, à l'âge de douze ans, il apparait dans le film "Streit um den Knaben Jo" dans lequel il incarne Erwin, qui aurait été échangé bébé avec Jo, interprété par Eberhard Itzenplitz,. La même année il joue un petit rôle dans "Serenade"*. La carrière de Klaus se poursuit avec d'autres petits rôles: en tant que groom dans Verwehte Spuren de Veit Harlan et en Chopin enfant dans "das Wunderkind", un film sur Chopin tourné en 1938. Ce film sera interdit par la censure et seulement projeté pour la première fois en 1950. Il apparait aussi dans le film historique Preußische Liebesgeschichte.
dans Kadett Hohenhausen
L' un de ses plus grands rôles a été en 1939 dans Kadett Hohenhausen tourné par Karl Ritter. Le film est un film de propagande anti-russe sur les cadets prussiens capturés et maltraités par des cosaques au cours de la guerre de Sept Ans. Il ne sortira qu'en 1941. Il ne pouvait initialement pas être projeté à cause du pacte Hitler-Staline. Ce n'est qu'en décembre 1941 qu'il arrivera dans les cinémas allemands, après l'attaque de l'Union soviétique. Klaus enchaine avec "Aus erster ehe" avec Ferdinand Marian dans lequel il a un rôle secondaire. Il retrouve un premier rôle dans "Kopf hoch, Johannes"* tourné pendant l'été 1940. Sierck incarne un garçon qui est rentré d'Argentine et qui, après des problèmes d'intégration, a finalement appris à aimer le système de valeurs de la nouvelle Allemagne nationale-socialiste dans une Napola. Alors que c'est un grand succès populaire, curieusement, ce film de propagande fut cependant peu apprécié par Goebbels.
dans Kopf hoch, Johannes
Il tournera son dernier film fin 1941; ce sera un film historique: Der große König (Le grand roi) dans lequel il joue le prince Henri. Le film est dirigé par Veit Harlan. Avec un coût de production de 4 779 000 Reichsmark, Le Grand Roi est l’ un des films les plus coûteux du régime nazi. Veit Harlan note dans ses mémoires qu'il a pu disposer des scènes de bataille avec de vrais soldats et 5 000 chevaux. Hitler fut extrêmement enthousiasmé par le film... Mais pas Goebbels qui trouvant Klaus trop efféminé fera couper certaines de ses scène et l'interdira d'écran. Il joue quelques temps dans un théâtre en Pologne, puis en 1943 il est envoyé sur le front de l'est.
Klaus Detlef Sierck sera tué, en Ukraine en mars 1944. Sa tombe est dans le cimetière militaire Iwaniwka.
Pour nous narrer les vies parallèles de Douglas Sirk et de son fils, l'auteur à la mauvaise idée de se mettre en scène dans le rôle d'un étudiant de cinéma qui va débusquer Douglas Sirk à Lugano, où il s'est retiré, pour le faire parler de sa carrière et surtout de son fils. Le premier problème est que l'auteur, ou du moins son double de papier, est parfaitement inintéressant. Il ne sembla avoir aucune vie sociale sinon avec sa directrice de thèse. On aura à la toute fin du volume, si on lit les remerciements la raison de la fadeur des passages où Denis Rossano apparait et le coté artificiel de ses rencontres avec le Sirk. Cela pour la bonne raison qu'il ne l'a jamais rencontré et n'a fait que prendre à son propre compte les entretiens que Jon Halliday a eu avec le cinéaste***. Certes Denis Rossano a mêlé des passages de cette interview avec d'autres sources mais on n'est pas loin du plagiat. On me rétorquera que le fait de mettre roman sur la couverture autorise toutes les libertés mais le procédé me parait parfaitement malhonnête. Ce qui m'amuse c'est les quelques critiques que j'ai pues lire sur ce livre, leurs auteurs n'ayant visiblement pas lu les remerciements ne se sont pas aperçus du subterfuge!
En ce qui concerne la construction du livre, Denis Rossano alterne les chapitres, tous brefs, parfois à peine deux pages, écrits à la troisième personne dans lesquels il reconstruit les parcours parallèles de Klaus et de son père, ces chapitres sont les meilleurs car l'auteur parvient à y insuffler de l'émotion, avec ceux écrits à la première personne dans lequel il raconte ses investigations sur la piste de Klaus Sierck et ceux là sont ennuyeux. On ne dira jamais assez combien "le journaliste gonzo" a fait du mal à la littérature, n'est pas Tom Wolf qui veut. On assiste donc par le menu à l'enquête que mène, au début des années 80 (mais qui est en fait une enquête de deuxième main comme je le mentionne plus haut), le narrateur, alors jeune critique de cinéma, auprès de Sirk, qui termine ses jours à Lugano en Suisse, au bord du lac, pour savoir qui était Klaus. Mais que peut lui dire Sirk au soir de sa vie sinon ressasser ses remords et ses regrets, lui qui n'a jamais revu l'enfant après son divorce alors que Klaus n'a que quatre ans. L'auteur est contraint d'inventer la vie de ce garçon...
Zarah Leander dans "La habanera"
En quelques phrases sèches, Denis Rossano, bon connaisseur du cinéma allemand de la période nazi nous expose les drames et les errements moraux de plusieurs protagonistes de ce cinéma. On apprend beaucoup de chose sur le cinéma allemand pendant la période nazie. C'est la partie la plus intéressante du livre mais un essai aurait mieux convenu et cette période dans les milieux du théâtre et du cinéma est tellement plus incarné dans le "Méphisto" de Klaus Mann... Plutôt que de s'égarer dans le roman pour lequel il n'est pas armé, Rossano devrait nous donner une histoire du cinéma nazi, qui, en regard de certains chapitres d'"Un père sans enfant" serait sans aucun soute très réussie.
Le principal intérêt du livre est de nous apprendre que ce drame du fils sacrifié au Moloch nazi, cette douleur, ce manque marqueront toute la vie de Douglas Sirk et surtout son oeuvre cinématographique, du moins c'est la thèse qu'avance l'auteur. Espérons que les lecteurs de ce pensum pour cinéphiles leur donnera l'envie de voir ou de revoir "Mirage de la vie " ou "Le temps d'aimer et le temps de mourir " ou encore "La Habanera" du grand Douglas Sirk.
Il reste à rêver sur la belle couverture du livre et se construire en songe, son propre roman. Enfin "Un père sans enfant" sort de l'oubli ce joli martyr, comme quoi un livre médiocre peut être une bonne action...
Klaus comme Kadet Hohenhausen dans Kadetten de Karl Ritter ( filmé 1939)
* On peut acquérir ce film sur ce site: https://filmhauer.net/serenade-1937-p-8043.html
** On peut acquérir ce film sur ce site: https://filmhauer.net/kopf-hoch-johannes-1941-p-6982.html
*** Conversation avec Douglas Sirk de Jon Halliday, éditions des Cahiers du cinéma















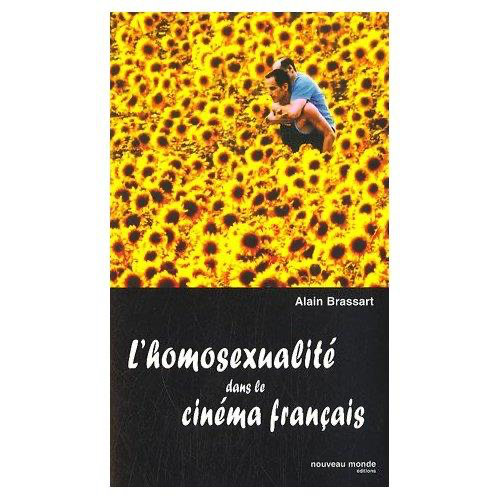











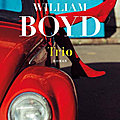



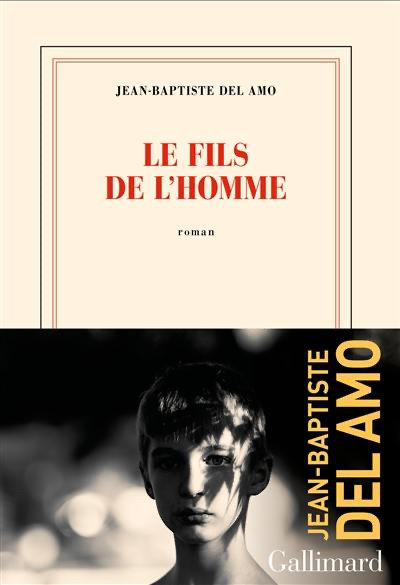

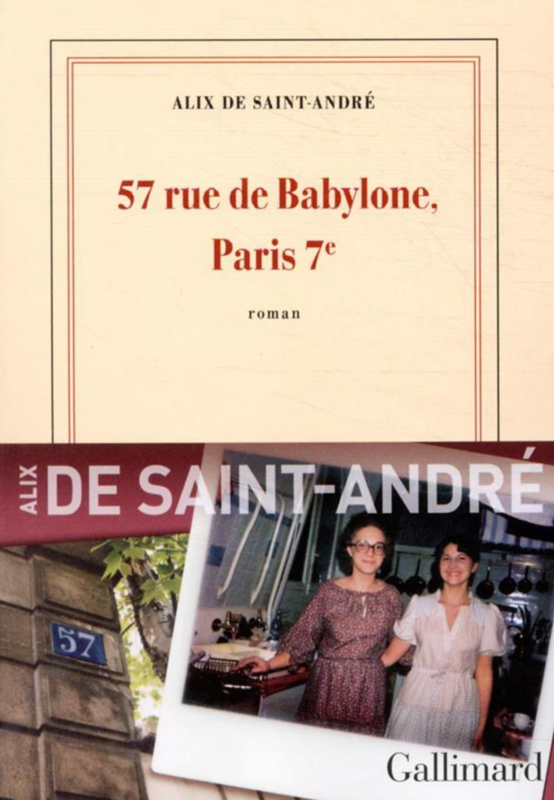



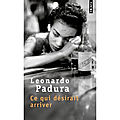
Bernard,
J'ai lu cette semaine l'ouvrage que tu chroniques ici. Même si je n'ai ni ton savoir cinématographique ni tes compétences filmiques, je suis resté - à sa lecture - sur ma fin : Absence totale des courts métrages. A la trappe Vincent Dieutre, Philippe Vallois, Gérard Blain...
J'ai toujours un grand plaisir à découvrir tes analyses souvent mordantes et bien argumentéres.
Voilà un commentaire qui va faire frétiller notre Bernard ! Il est trop modeste pour te répondre. A moins que je ne me trompe...
Daniel (ton lecteur number 1)