La route de Cormac McCarthy
La route de Cormac McCarthy (1933-2023) a obtenu le prix Pulitzer en 2007 soit la plus haute récompense littéraire aux Etats-Unis ce qui est d’autant plus remarquable que ce livre est un roman de genre et plus précisément un roman post-apocalyptique, sous genre cousin de l’uchronie et encore plus encore de la dystopie, genres et sous-genres que l’on rattache un peu curieusement à la science-fiction.
Le roman post-apocalyptique est devenu au fil des années un genre en soit dont les premiers, du moins ceux qui ont connu une audience importante, sont apparus au tout début du XX ème siècle avec en Europe, « La mort de la terre » de J. H. Rosny Ainé (1910) mais c’est plus en Amérique avec « Le nuage pourpre » de Matthew Phipps Shiell (1901) que le genre nait vraiment et impose ses règles. En 1826 Mary Shelley avait bien écrit « Le Dernier Homme » mais dans ce cas nous sommes plus dans le conte philosophique que dans le roman. Le livre de Shiell aura de multiples avatars principalement aux Etats-Unis à commencer par « La peste écarlate » de Jack London. C’est la floraison des pulps des années 30 aux années 60 et le contexte international, la naissance de l’arme nucléaire, la guerre froide… qui permettons aux récits de fin des hommes de se multiplier principalement sous forme de nouvelles; les plus mémorables étant sans doute celles de Philip K. Dick. Mais c’est en Europe que l’on trouve les chefs d’oeuvre du genre avec en France, « Ravage » (1941) de Barjavel puis « Malevil » (1972) de Robert Merle et en Grande Bretagne « Le jour des Triffides » de John Wyndham.
Mais « La route » est-il un roman post apocalyptique car contrairement à la quasi totalité du corpus du genre, le futur, la prospective, la mise en garde n'intéressent pas McCarthy.
« La route » offre la possibilité de deux lectures, deux lectures à faire successivement. Il est difficile lorsqu’on découvre le livre de ne pas le considérer comme un roman post-apocalyptique en ayant hâte d’arriver à la dernière page pour connaitre prosaïquement ce que deviennent les deux héros de ce qu’au cinéma on nommerait un road-movie. Arrivé à cette fin à la fois la richesse sous-jacente du livre et quelques défauts si l’on s’en tient à cette lecture au premier degré, invitent son lecteur à reprendre le livre et cette fois à le considérer comme une fable métaphysique.
« Le thème de la fin du monde est aussi ancien que la peur de mourir.», écrit Jacques Goimard. Suivant les auteurs et les époques, l’apocalypse sera causée par une pandémie (« Le monde enfin » de Jean-Pierre Andrevon), la pollution, la disparition d’une ressource vitale (l’électricité dans « Ravage »), une catastrophe naturelle, la collision de la terre avec une météorite, une guerre bactériologique, un enfer technologique, une attaque extraterrestre ou même une invasion de zombies (« Je suis une légende » (1954) de Richard Matheson) ou encore… la main de Dieu.
Dans le roman de McCarthy l’apocalypse a eu lieu. Quand, on ne le saura pas; pas plus que l’on connaitra la nature de la catastrophe qui a carbonisé la planète, attaques nucléaires, éruptions volcaniques en chaine? La terre est couverte de cendre. Tout comme dans « Un cantique pour Leibowitz » (1960) de Walter M. Miller on peut dire qu’un grand déluge de flammes a balayé la planète. Presque toute la population a disparu. Il n’y a plus aucun animal. Dans ce monde gris et noir dans lequel le soleil est obscurci par des nuages de cendre, un père et son fils errent sur la route en direction du sud et de la mer, leur Graal, vers un paradis perdu. Comme dans « Le monde enfin « d’Andrevon, la mer semble être le dernier spectacle souhaité avant la mort. Ils cheminent en poussant un caddie dans lequel s’entassent leurs maigres et dérisoires trésors de survie, des couvertures pour combattre le froid dans ce qui semble être un éternel hiver, quelques boites de conserve échappées à la destruction et aux pillages. << Marchant sur le monde mort comme des rats tournant sur une roue». Contrairement au héros du « Nuage pourpre », le père et le fils ne sont pas les seuls survivants du cataclysme, il y a les « méchants » qui pour subsister se sont fait cannibale… Depuis quand cheminent-ils on l’ignorera également. Habituellement pour maintenir le suspense, les romans post apocalyptiques, ce sont presque toujours des « survivals », le lecteur n’en sais pas plus que les héros. Dans le cas présent il en sait moins…
S’il est difficile d’abandonner le livre avant son ultime page, qui offre une fin ouverte, ce qui peut paraitre une facilité narrative, mais la plus grande difficulté pour l’auteur de ce type de récit n’est-il pas justement de conclure, l’absence d’informations sur les deux protagonistes principaux de cette aventure n’aide pas le lecteur à entrer en empathie avec eux. On ne connait rien de leur aspect physique sinon qu’ils sont squelettiques. On ne sait pas non plus leur nom. Ils sont désignés comme étant l’homme, le père, l’enfant, le fils. Même lorsque l'homme se souvient d'un dialogue avec sa femme, il l'appelle "femme". Ainsi même les rêves et les souvenirs sont dépersonnalisés. Dépersonnalisation ou je pencherais plutôt vers la volonté de faire des deux personnages principaux des symboles. On ignore leur âge. On peut envisager que l’enfant a environ huit ans quand se termine le récit qui déroule sur quelques mois. Au fil des pages il nous ait révélé que l’enfant est né peu de temps après la catastrophe. Ce qui nous renseigne sur le laps de temps qui s’est déroulé depuis car on peut faire une supposition plus ou moins fiable sur l’âge de l’enfant. Si nous n’avons guère de doute que nous sommes aux Etats-Unis et très probablement que le père et son fils se dirigent vers le sud de la cote est, néanmoins il y a peu de repères géographiques pour que nous sachions d’où ils partent et où ils arrivent au terme de leur périple. Lorsqu’un méchant rencontré, demande au père s’il est médecin, suite à une description précise que le père lui a fait des conséquences s’il tire sur lui, il répond je suis rien. On n’en apprendra pas plus sur le métier de l’homme avant la catastrophe.
La route est aussi une sorte de roman d’apprentissage. Le père multiplie les occasions d’apprendre à son fils à survivre mais pas plus contrairement à cet autre conte philosophique qu’est « Sa majesté des mouches » de Golding le père qui est sur ce point le porte parole de l’auteur à la certitude que la barbarie ne peut être vaincue par le savoir.
Comme pour tous les récits post-apocalyptiques, « La route » doit beaucoup aux robinsonades et en particulier à l’ouvrage fondateur du genre, « Robinson Crusoe » de Daniel Defoe. Les héros de « La route » sont confrontés au même problème que le naufragé de « Robinson Crusoé » soit survivre en récupérant les quelques restes qui pour l’un ont survécu au naufrage pour les autres au grand incendie planétaire. Un épisode de « La route » (page 199) lorsque le père fait une visite périlleuse dans un yacht échoué, parait être un démarquage du chapitre dans lequel Robinson récupère quelques ustensile dans son ancien navire lui aussi drossé sur la grève (page 117* dans l’édition de la Pléiade de 2018).
Le livre n’est pas chapitré mais est découpé en courts paragraphes dont la longueur varie de quelques lignes à trois pages au maximum. McCarthy fait alterner le récit factuel de l’éprouvante pérégrination de ses deux personnages avec des descriptions des paysages qu’ils traversent. Le roman est alors comme contaminé par une poésie romantique. Ces courts poèmes en prose ne nous donnent pas des images dynamiques comme pourrait le faire un écrivain voyageur tel Bouvier ou Tesson par exemple mais des instantanés figés qui font un peu penser à ceux des romans de l’écrivain géographe qu’est Julien Gracq ou certainement plus connus de McCarthy aux descriptions de paysage de Jim Harrison. Ce coté immobile des descriptions renforce le sentiment que les deux protagonistes avancent lentement et dans un paysages toujours recommencé en noir et gris dans lequel la couleur est bannie. La couleur se réfugie dans les rêves du père ou plutôt ses cauchemars. Ceux-ci sont révélateurs des influences picturales de l’auteur. Page 9, la créature qui apparait dans le songe du père ressemble, au début du moins à celle du tableau « Cauchemar » de Fussli. Puis elle évolue vers un monstre qui aurait pu être peint par Frank Frazetta. Autre réminiscence picturale celle des peintures au romantisme sombre de Caspar David Friedrich auxquelles m’a fait songer dans les dernières pages du roman la vision terrifiante d’une mer dans laquelle toute vie est bannie, une étendue uniformément grise sans le cri d’un seul oiseau.
Au fur et à mesure que le récits avance, ces intermèdes qui sont générés par les réflexions silencieuses du père se raréfient, l’homme rassemblant ses moindres forces pour survivre un jour de plus, la couleur s’efface. Pourtant c’est une strophe poétique, assez incongrue qui clôt le roman, incongrue du moins si l’on veut voir dans « La route » qu’un roman post-apocalyptique et non une fable philosophique.
Mais c’est surtout dans le cinéma qu’il faut chercher les images qui ont influencées l’écrivain. Page 25 l’évocation de la disparition des fresques antiques lorsqu’elles sont exposées à la lumière rappelle immédiatement une célèbre scène du film Roma Roma de Fellini. La troupe militarisée de méchants à la page 59 sort tout droit de Mad Max; quand au garde-manger des cannibales, à la page 102, il aurait sa place dans les plus sanglants des films gores.
Autres intermèdes au récit du cheminement, les dialogues entre le père et le fils. Ils se démarquent en général nettement du récit par un retour à la ligne à chaque mot ou phrase courte prononcé par l’un ou l’autre des deux locuteur, mais ils sont rarement introduits. Ces échanges verbaux minimalistes sont très répétitifs et il faut avoir une grande indulgence pour l’enfant pour les supporter. Ils sont constitués de phrases très courtes en un vocabulaire pauvre avec beaucoup de mots récurrents.
Si le monde meurt, avec cette mort le nom des élément qui constituaient l’univers meurt également: « Le monde se contractant autour d’un noyau brut d’entités sécables. Le nom des choses suivant lentement ces choses dans l’oubli. Les couleurs. Le nom des oiseaux. Les choses à manger. Finalement les noms des choses que l’on croyait être vraies. Plus fragiles qu’il ne l’aurait pensé. Combien avaient déjà disparu ? L’idiome sacré coupé de ses référents et par conséquent de sa réalité. Se repliant comme une chose qui tente de préserver la chaleur. Pour disparaître le moment venu. », (p. 80) d’ou le vocabulaire minimaliste dans la plupart des paragraphes sauf dans quelque rares où la langue se fait baroque. Cette aridité des dialogues contraste avec certains passages dans lesquels McCarthy dans des descriptions de mécanismes et d’objets utilise des mots techniques assez rares avec profusion atteignant une sorte de lyrisme technique (c’est du moins l’impression que donne la traduction de François Hirsch.). On n’est pas loin dans ces passages de Jules Verne.
Le non apprentissage parle père à son fils d’un vocabulaire désignant les objets de la civilisation défunte peut, comme presque tout dans « La route » être interprété de plusieurs façons. C’est probablement dans l’esprit du père que si le garçon ne sait pas nommer une chose celle-ci ne réapparaitra pas dans une éventuelle future organisation du monde et donc ne conduira pas, même très indirectement, à une nouvelle catastrophe. L’objet dans l’esprit de McCarthy peut prendre corps uniquement si on peut le nommer. Plus prosaïquement si le père n’inculque à son fils que peu d’apprentissages et de mots ce n’est peut être pas, ou pas seulement par défiance du savoir, mais parce que l’enfant ne serait pas capable d’apprendre mots et concepts qui lui sont étranger n’ayant connu qu’un monde détruit.
L’abolition des mots s’accompagne de l’abolition du temps ou du moins de sa comptabilisation. L’homme contrairement au Robinson de Daniel Defoe ne tient pas un calendrier. Il ignore depuis combien de temps son monde est détruit. Le cycle des saisons ayant disparu. Les personnage semblent vivre dans un temps immobile.
L'auteur emploie généralement des phrases courtes, parfois nominales. Les participes présents ou passés sont très fréquents. Ces procédés renforcent la concision du texte tout en ajoutant une sensation de pesanteur, d'immobilisme. Certains mot sont souvent répétés créant un effet de scansion. Dans la même idée la multiplication de la conjonction de coordination donne à quelques phrases une forme de litanie. La ponctuation ignore la virgule.
McCarthy joue sur les contrastes aussi bien dans la forme que sur le fond, pour tenter de rompre la monotonie du récit. Par exemple la mort du père est traité abruptement tandis que la maladie du fils offre les seules plages de tendresse dans cette histoire (page 219). L’angoisse du père, près de son fils malade m’a rappelé celle de la grand-mère près de son petit-fils dans « Le sixième jour » d’Andrée Chédid.
Ce qui fait horreur, dans « La Route », ça n’est pas uniquement la description de l’anthropophagie, c’est d’abord que l’être humain accepte de voir dans l’être humain une source de nourriture ordinaire, normale. La conscience de ce fait, pour le lecteur, se fait progressivement. Au début les méchants sont pensés par lui comme simplement des « brigands », ou des « pillards ». On n’a des soupçons de l’existence du cannibalisme qu’à la page 67 et sa confirmation page 102: << Les dents grises en train de pourrir. Gluantes de chair humaine. Qui a fait du monde un mensonge, un mensonge de chaque mot.>>.
Si dans « La route » McCarthy a poussé à l’extrême sa fascination des ruines et celle de la déliquescence d’une société, ces thème étaient déjà présents dans ses quatre premiers romans qui appartiennent au genre « Southern Gothic », genre caractérisé par ses paysages de marécages, de bayous, ses plantations à l'abandon, les lieux reculés où vivraient des personnages tarés aux coutumes et croyances macabres. « La Route » tranche sur le reste de la production de McCarthy dans laquelle l’homme est confronté à une Nature, magnifique mais dangereuse et cruelle. Dans la route l’homme est le probable assassin de la nature. L’écrivain n’est pas novice non plus dans la peinture de la violence. Elle est presque à chaque page de « Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme » adapté au cinéma par les frères Coen. C’est surtout dans No Country for Old Men que l’on peut repérer les prémices de « La route » comme dans les toutes dernières lignes de ce roman qui évoquent un rêve du shérif lorsqu’il était un enfant, dans lequel il accompagne dans la nuit son père qui, avec une lampe rudimentaire, s'enfonce dans les ténèbres ces ultime ligne, déjà un rêve, le rêve est très présent dans la route, semblent annoncer La route où un homme accompagné de son fils avancent sans relâche, car l'immobilité serait synonyme de mort.
Le ciel dans les récits apocalyptiques est souvent vide, alors qu’inconsciemment en occident du moins on peut faire remonter le genre aux récits bibliques. « La route » ne fait pas exception. Si le père s’adresse au ciel celui-ci semble sans dieu. Le catholique Cormac McCarthy invente un concept étrange à propos de l’enfant celui qui porte le feu, entendons l’espoir, celui d’un prophète sans dieu (page 152). Concept qui pourrait être illustré par cette extrait du « mythe de Sisyphe » de Camus: « Dans un univers soudain privé d’illusions et de lumières, l’homme se sent un étranger. Cet exil est sans recours puisqu’il est privé d’une patrie perdue ou de l’espoir d’une terre promise. Ce divorce entre l’homme et sa vie, l’acteur et son décor, c’est proprement le sentiment de l’absurdité. ».
Le catholicisme de l’auteur pourtant transparait dans des phrases comme celles-ci: << un flocon de neige tomba sur son gant telle la dernière hostie de l'ère chrétienne.>> ou encore: << Les cheveux de l’enfant sont un “calice d’or, bon pour abriter un dieu>>.
A la page 145 Le père et le fils rencontre un vagabond qui dit se prénommer Elie, le livre de Cormac McCarthy fait alors référence à la fois à un passages des Evangiles, celui de Luc, avec la parabole du Bon Samaritain et à épisode de la bible du Premier Livre des Rois. Dans celui-ci Élie est un prophète, le porte-parole de la volonté de Dieu. Il fuit une mort certaine promise par Jézabel, Élie, dans le désert s’endort en souhaitant ne pas se réveiller. Un ange le touche et lui dit « Lève-toi et mange », lui offrant une galette et une gourde d’eau. Le père et le fils sont à la fois les bons samaritains, ils donnent un peu de nourriture au vagabond et l’ange de la bible. L’Élie de La Route, croisant le père et le fils, n’a-t-il pas cru, voyant l’enfant, à l’apparition d’un ange ? A la fin du livre, le père mourrant verra une aura de lumière autour du petit (p. 244).
L’utilisation du mot feu pour symboliser l’espoir est surprenant dans la mesure où il semble que ce soit principalement le feu qui soit responsable de la destruction de la vie même s’il n’en est pas probablement la cause mais la conséquence.
L’originalité de « La route » c’est ce que l’on pourrait appelé sa neutralité et son « présentisme ». Le père, seul être pleinement conscient de l’Histoire, ne tente presque pas de se remémorer le passé. Il veut même l’abolir en abandonnant sur la route la seule image qui lui restait de sa femme. Non pour se libérer des souvenirs mais plutôt pour renforcer sa dépersonnalisation pour tendre vers le rien.
L’enfant est né peu de temps après le cataclysme. Il n’a donc pas de souvenir du monde d’avant.
Si le passé est non renié mais comme volontairement oublié, on remarquera que contrairement à ce que l’on peut lire dans de nombreux romans post-apocalyptiques le héros ne vitupère pas ni contre un dieu ni contre l’hubris des hommes comme dans, par exemple « La planète des singes » de Pierre Boule.
L’avenir n’est pas plus envisagé alors que la raison d’être de la plupart des ouvrages s’inscrivant dans le genre est de proposer une société alternative à celle qui a conduit à l’anéantissement de l’ancienne. Par exemple prôner une sorte de retour à la terre dans le « Ravage » de Barjavel ou tendre vers un mode de vie frugal et égalitarisme chez Jean-Pierre Andrevon ou même un retour à une société primitive comme dans « Niourk » de Stéphane Wul.
Si l’on peut se réjouir que le flou et les ellipses du récit offrent une grande liberté d’interprétation du roman, on peut aussi soupçonner que c’est une facilité narrative qui évite à l’auteur des explications laborieuses sur la cause de la catastrophe ou encore d’approfondir la psychologie du père.
Dans ce type d’ouvrage, pour que l’intérêt du lecteur ne faiblisse pas, il ne faut pas que celui-ci puisse mette en doute la crédibilité du récit. Ce qui n’est pas complètement le cas ici. On se demande tout de même ce qui a pu à ce point annihiler toute forme de vie et surtout pourquoi quelques êtres humains ont réussi à survivre sans être terrés au fond d'un bunker. De même on peut trouver que nos héros ont bien de la chance de découvrir, à chaque fois qu’ils sont sur le point de mourrir de faim, une cache providentielle de nourriture qui les sauve et ainsi ils peuvent rester des gentils; soit ceux qui ne mangent pas leurs semblables. Enfin on peut voir la fin, l’irruption de cette inattendue famille d’accueil, alors que jusque là on avait pas croisé un seul « gentil », comme une sorte de tour de passe passe pour terminer le roman.
Si l’on peut interpréter la fin du livre comme une fin optimiste avec « cette famille » qui recueille l’enfant après la mort du père. On peut néanmoins s’interroger sur celle-ci. Ne serait-elle pas un leurre? Ainsi la route, ce symbole de l’Amérique ne mènerait nulle part.
Il reste que le respect et le soin envers le corps du père que prend le découvreur de l’enfant rend enclin à penser que l’enfant est sauvé, du moins momentanément mais n’est-il pas le porteur « du feu »… Le fils est désigné par son père comme le « gardien du feu divin » (p. 34). « S'il n'est pas la parole de Dieu, Dieu n'a jamais parlé » (p. 11).
Lorsque le père meurt l’enfant n’a pas encore rencontré celui qui le recueillera. Le père a fait son devoir mais ignorera que son fils sera sauvé. Comme lorsque l’on meurt on ne connait pas la suite des histoires… C’est aussi ce que veut nous dire Cormac McCarthy qui a plus de soixante-dix ans lorsqu’il écrit « La route ».
Le dernier paragraphe exprime le deuil non de l’homme ou de la civilisation mais celui de la nature et des animaux: << Autrefois il y avait des truites de torrent dans les montagnes (…) Une chose qu’on ne pourrait pas refaire. Ni réparer…>>. L’homme n’est pas la victime mais le bourreau de la nature. Le destructeur d’un paradis qu’il ne méritait pas.
L’idée de « La Route », qui est aussi une ode à l’amour paternel, serait venue à McCarthy, quelques années avant qu’il se mette à la rédaction de son roman, auprès de son tout jeune fils endormi…
* Les numéros de page font référence à l’édition en poche de « La route » Point Seuil de mars 2023.

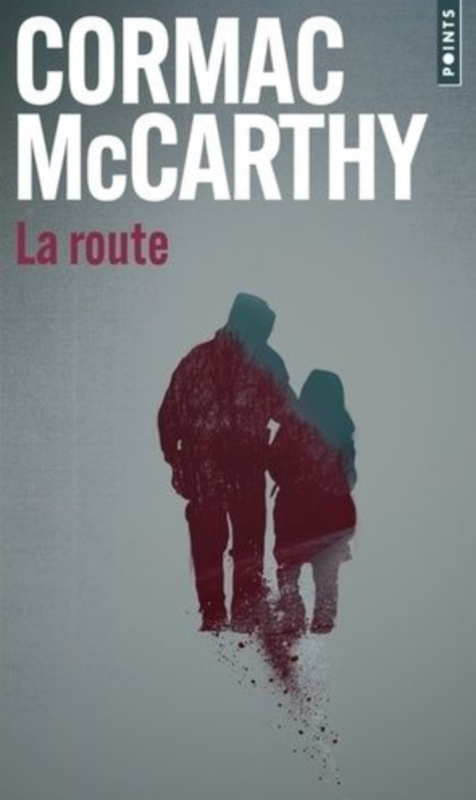


/image%2F1239667%2F20240503%2Fob_ede992_capture-d-ecran-2020-03-22-a-16-13.png)
/image%2F1239667%2F20240502%2Fob_16b0d7_18793593.jpg)
/image%2F1239667%2F20240502%2Fob_6214d3_img-9516.jpeg)
/image%2F1239667%2F20240418%2Fob_af373f_capture-d-ecran-2024-04-18-a-13-52.png)